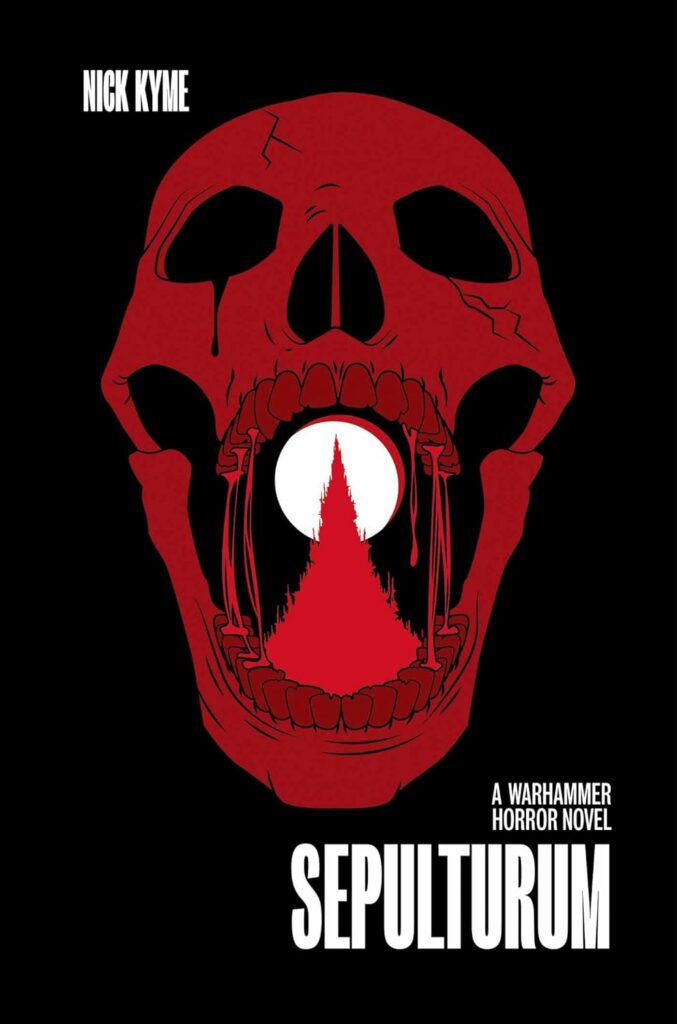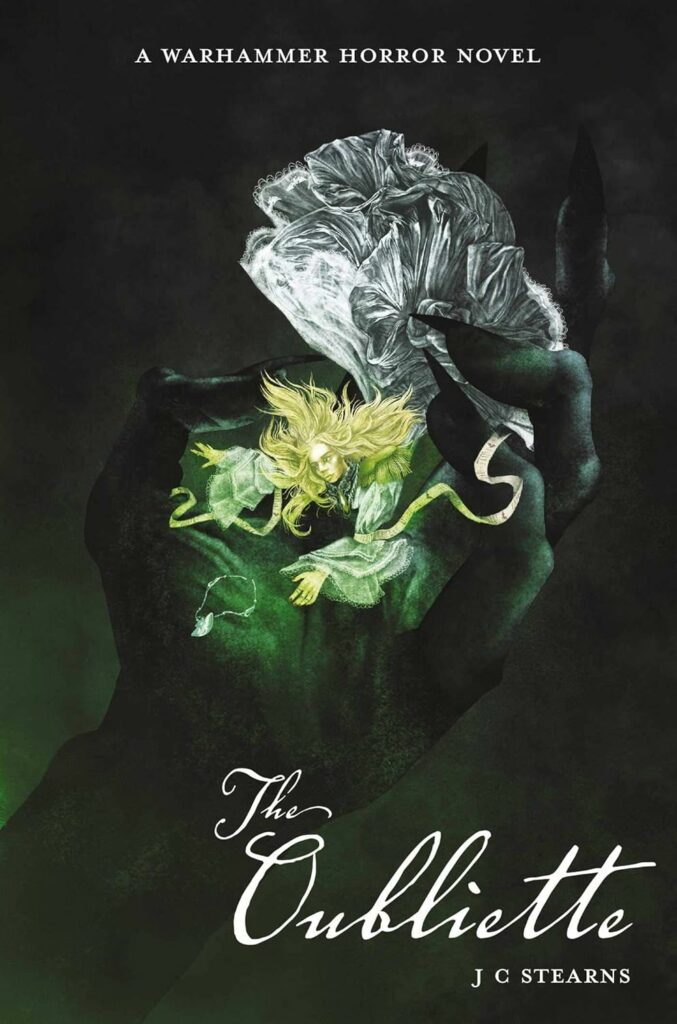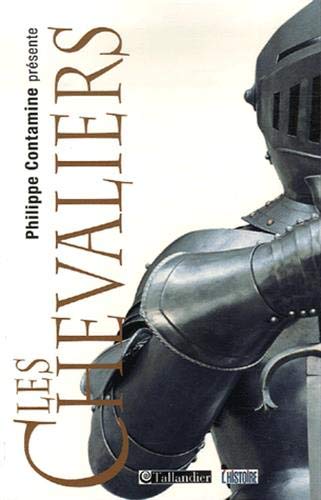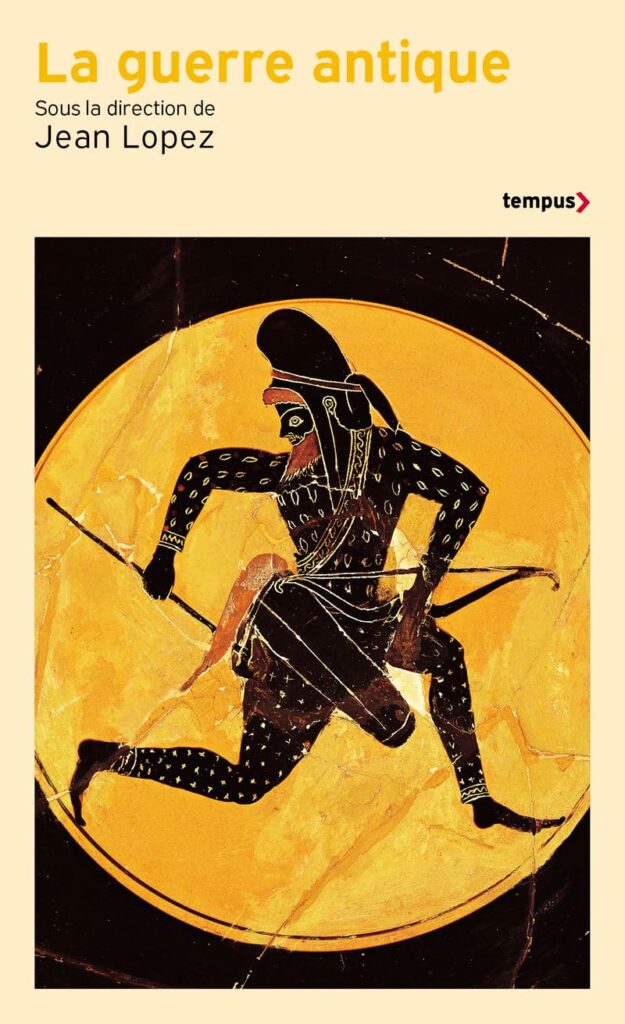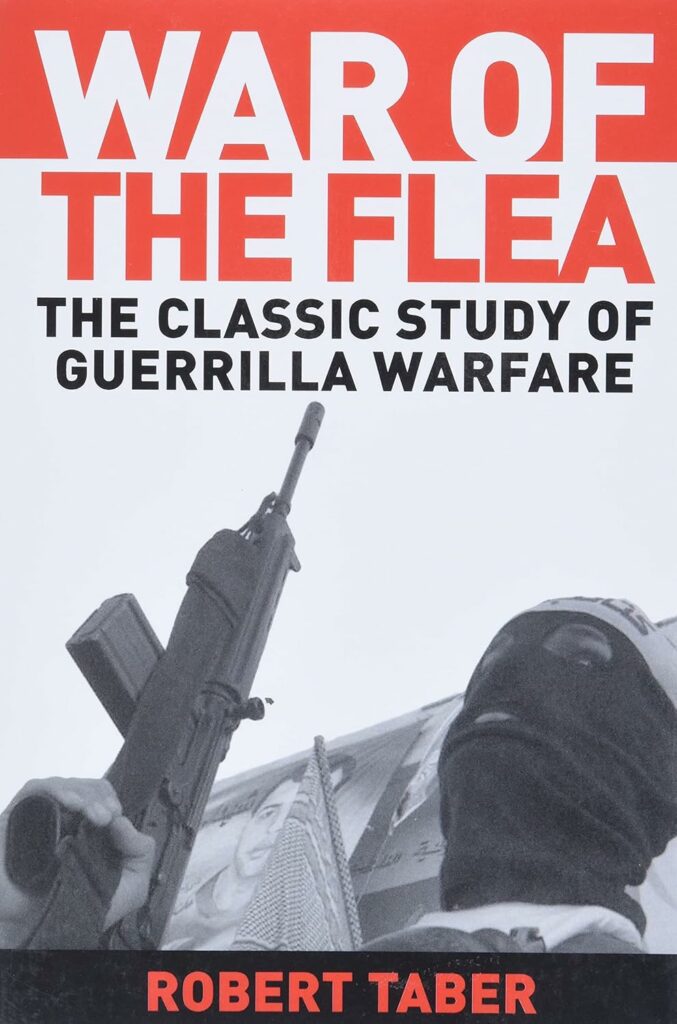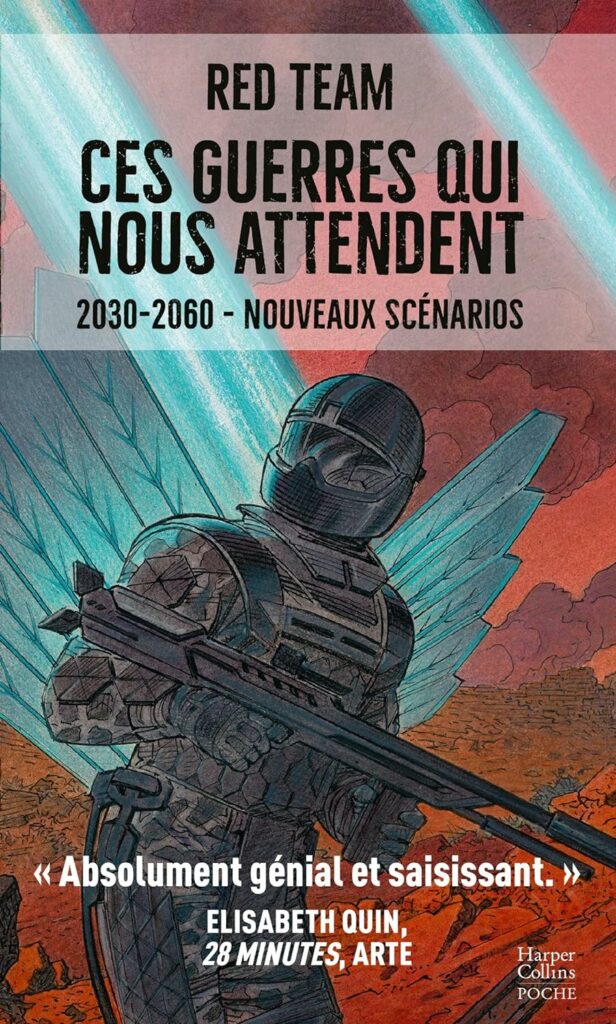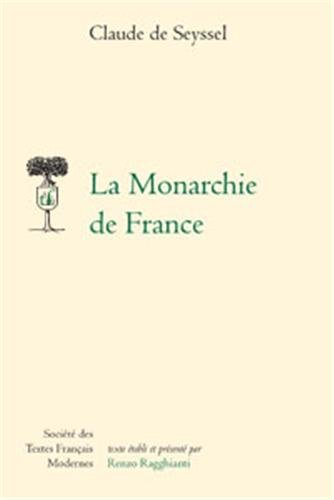Le monde se divise en deux catégories: ceux qui ignorent le nom de William Luther Pierce, et ceux qui le connaissent.
Peu d’auteurs dans le monde peuvent se vanter d’être aussi controversé que celui-ci. Pierce était un auteur américain, né le 11 septembre 1933 et mort le 23 juillet 2002. Violemment raciste et antisémite, Pierce a écrit deux romans, dont un, surtout, est devenu une référence « incontournable » dans les milieux ultra-nationalistes voire volontiers néo-nazis. Ils sont quasiment introuvables en langue française, bannis d’Amazon et des autres grandes plateformes de distribution, et Les Carnets de Turner a même fait l’objet, en 1999, d’une interdiction de publication en France, abolie depuis mais faisant semble-t-il toujours l’objet d’une sérieuse autocensure même de la part des éditeurs « underground ». En fait, même la maison d’édition qui a édité ceux que j’ai lu ne les a pas à son catalogue, et j’ai dû aller chercher les deux romans outre-manche…
Le souffre qui entoure ces écrits est tel que des personnes ayant maille à partir avec les services de l’Etat ont pu être incriminés sur la seule détention de ces ouvrages, qui les cataloguent comme « néo-nazis ». Chaque fois que vous lisez dans un article sur un coup de filet dans les milieux d’extrême droite que la ou les personnes détenaient de la « propagande néo-nazie », il y a de bonnes chances que les Carnets de Turner en faisaient partie. Personne ne pouvant les lire, il est difficile de les juger. J’ai donc pris sur moi de me les procurer, et d’en parler.
Les Carnets de Turner
Rédigé en 1978, ce roman est LE roman de William L. Pierce. Il est également celui qui est l’objet de la plus vive controverse. Que raconte-t-il?
Les « Carnets » se présentent sous la forme d’un journal intime, narrant les événements de la « grande révolution » américaine, qui débute en 1991. Le déclencheur est une loi passée par le gouvernement des USA visant à interdire la détention d’armes à feu (votée en 1989), et qui aboutit à des arrestations massives de militants « de droite » le 16 septembre 1991. Le personnage principal, Earl Turner, bascule dans la clandestinité pour éviter d’être arrêté. Membre d’une organisation dont on ne saura jamais le nom, mais vraisemblablement calquée sur le modèle des ligues dites « néo-nazies » de la fin des années 1970, Turner montre dans ses carnets comment l’organisation se coordonne pour riposter contre le gouvernement. Les « camps » sont assez manichéens, avec d’un côté les « blancs ayant conscience de leur race », et de l’autre, le ZOG, acronyme désignant le « Zionist Occupied Governement ». Vous le comprenez, le roman de Pierce est non seulement violemment raciste, mais également violemment antisémite.
Dans les Carnets, on suit donc Turner dans ses péripéties, que l’on peut diviser en trois phases. La première est celle de la clandestinité, avec une organisation en cellules, les unes dédiées à la propagande, les autres à des actions plus directes. Turner est électronicien et chargé de la communication entre les cellules, et à ce titre est amené à rencontrer divers profils de l’organisation. Il regrette régulièrement que même au sein de l’organisation, parmi les militants désormais entrés en clandestinité, les motivations ne sont pas toujours réellement idéologiques et sont souvent le résultat des circonstances. D’un autre côté, il se rend compte qu’au sein même de l’organisation existe un groupe quasiment ésotérique, beaucoup plus idéologique et fanatique, qu’il finit par rejoindre en tant qu’aspirant. Puis vient la rupture: Turner est arrêté au cours d’une opération antiterroriste, et emprisonné. Torturé, il essaie de résister mais finit par parler, sans révéler l’existence de l’organisation au sein de l’organisation.
Lorsqu’il est finalement délivré du camp où il est interné au cours d’un assaut massif mené par des membres de l’organisation, il est jugé par le groupe secret: il est condamné à mort pour avoir parlé. Mais en raison de ses états de service exceptionnels, il obtient de pouvoir mourir en martyr au cours d’une action d’envergure qui permettra de vaincre le ZOG.
A partir de là, le ton du roman bascule, car l’organisation parvient à s’emparer de la Californie. Là où la première partie mettait en jeu des actions de résistance/terrorisme, la seconde vire à la guerre civile ouverte, avec d’un côté les blancs, et de l’autre, les noirs, les juifs, les latinos, les communistes… La tension n’en finira plus de monter, jusqu’à ce que l’arsenal nucléaire soit mis en oeuvre, rasant des dizaines de grandes villes américaines. Le ZOG, poussé dans ses derniers retranchements, résiste encore au Pentagone. Le roman s’achève alors que Turner s’apprête à s’envoler avec un avion bourré d’explosifs qu’il utilisera pour se fracasser contre l’édifice avant que ses camarades puissent lancer l’assaut final. On sait le résultat de l’opération depuis le départ, puisque l’avant-propos indique que les Carnets de Turner ont été retrouvés par hasard et donnent un aperçu unique sur les événements ayant mené à la Grande Révolution.
Sur le plan simplement littéraire, les Carnets n’est pas un grand roman, même s’il a des qualités romanesques indéniables qui rendent « crédibles » les événements qui se déroulent dans ses pages. Le racisme et l’antisémitisme y sont clairement débridés, mais ne sont pas simplement un défoulement de haine « masturbatoire » comme c’est souvent le cas dans ce genre de littérature. Ici, les personnages non blancs sont exécrables, les juifs sont décrits de manière fidèle aux stéréotypes qu’on attend de ce genre d’auteur, les noirs sont réduits à des brutes volontiers prédateurs sexuels (voire cannibales, après les événements les plus graves qui sont décrits dans le dernier tiers), mais les personnages blancs ne sont pas des parangons de vertu non plus et sont au final d’ailleurs plutôt transparents, justement absorbés dans le grand tout « les blancs ». Les quelques personnages décrits semblent surtout victimes des événements, rarement capables de surmonter ce qui se passe sans subir des traumatismes importants, et ne trouvent finalement leur force que lorsqu’ils sont rassemblés en groupes avec d’autres blancs, en étant « conscients de leur race ».
C’est là l’une des obsessions de William L. Pierce, qui ne cachait nullement ses opinions politiques, et qui sans surprise correspond à l’idéologie fasciste où l’individu isolé ne peut exister, à moins de prendre conscience qu’il est partie d’un tout, appelé « race blanche ». Même s’ils sont fortement imprégnés par cette idéologie, les Carnets n’est pas un roman idéologique. C’est un roman qui, si on en retire les tonalités racistes et antisémites, se révèle être finalement plutôt convaincant dans le domaine de l’action/espionnage, même si ce n’est certainement pas le roman de l’année. Il ne cherche pas à convaincre, mais plutôt à montrer « ce qui pourrait être », selon Pierce, une société « idéale », et comment y parvenir.
D’un certain point de vue, ce roman choque en Occident surtout parce qu’il met en scène des blancs en lutte contre des noirs et des juifs. Pour autant, la littérature sud-américaine, africaine ou asiatique, surtout lors de la période de la décolonisation et des années 1970, avec des personnages locaux en lutte contre les blancs, ne choque pas, voire sont parfois acclamés. Je vois dans les Carnets un contre-point à cette littérature-là, d’autant qu’il a été rédigé en 1978, période où le ressentiment post-colonial a été porté à son comble dans les pays dits du « tiers monde ».
Choquant, très certainement. Raciste et antisémite, sans aucune ambiguïté. Mais de là à l’interdire ou d’en empêcher la réédition… Il me semble au contraire que sa lecture le dédramatise énormément, un peu comme Mein Kampf qui a une aura de livre ultra-antisémite, et qui se révèle être une tirade imbuvable. Certains prétendent que c’est ce livre qui a inspiré Timothy McVeigh dans l’attentat d’Oklahoma City contre le siège local du FBI, mais je ne vois honnêtement pas vraiment le lien (c’est plutôt Hunter qu’on pourrait lier, à la limite…). Si on est capables d’éditer Sade, sans aucun avant-propos ni préface « dénonçant » le contenu, je ne vois pas trop pourquoi les Carnets ne pourraient pas l’être…
Chasseur
Rédigé en 1989, Hunter est le second et dernier roman de William Pierce. Si les Carnets pouvaient présenter un certain intérêt littéraire, ce n’est absolument pas le cas de Chasseur.
On suit les péripéties de Oscar Yeager, vétéran du Vietnam qui décide de lutter contre la « batardisation » de la race blanche en luttant contre le métissage. Pour ce faire, il abat des couples mixtes, jusqu’à ce que ses actes attirent l’attention des médias qui en pointent le racisme. D’autres tireurs commencent à l’imiter, même s’ils sont moins « pros » que Yeager… si bien que celui-ci décide de tuer du plus gros « gibier », en s’attaquant aux promoteurs même du métissage: religieux, politiques, personnalités… Il fait sauter une église où se tient un rassemblement contre le racisme, puis tue un politique membre du Congrès américain en l’étranglant dans les toilettes.
Cette première partie est, clairement, de la littérature masturbatoire, où le héros est un avatar de l’auteur lui-même: fier et sans reproche ni remords, le personnage/auteur tue sans jamais être inquiété, parce qu’il est méticuleux et bien préparé, et ses victimes représentent tout ce qui le dégoutent. Et puis le héros/auteur est un grand séducteur qui a une vie sexuelle exaltante avec une jeune femme incarnant tous les critères de beauté idéaux. C’est quasiment de la fanfic wattpad, pour vous donner une idée du niveau littéraire…
Le roman bascule assez vite, lorsqu’à la fin du premier quart, le « héros » trouve un soir un type qui s’avère être un enquêteur du FBI dans son salon. Loin d’être venu pour l’arrêter, il est en fait venu pour lui proposer un deal: si Yeager accepte de travailler pour lui, il lui donnera des cibles à éliminer, l’alternative étant d’être arrêté voire tué. Yeager accepte, et on entre dans un nouveau cycle d’attaques, qui se concentrent cette fois sur les juifs, ou plus exactement contre les agents du MOSSAD agissant sur le sol des USA, ainsi que leurs complices américains. Il commence par abattre un membre du FBI avec un pistolet à fléchettes empoisonnées qui déclenchent un infarctus, qui permet à son commanditaire d’assurer sa place à la tête du service où il travaille, puis celui-ci lui donne une liste de cibles potentielles à frapper comme il l’entend, la plupart étant juives. Pour couvrir ses actes, il doit faire accuser les palestiniens. Yeager fait sauter une papèterie servant de couverture au MOSSAD, puis tue un membre du congrès dans son propre bureau, ce qui provoque une réaction massive de la part du gouvernement. Son commanditaire est nommé à la tête d’une nouvelle agence contre le terrorisme, et… demande à Yeager d’arrêter.
Le roman tourne désormais à la pure propagande idéologique, plus exactement antisémite. Le « héros » ne comprend pas pourquoi il doit tuer des juifs, et s’ensuivent de très, très longues pages de discussions cherchant à expliquer pourquoi ce sont eux qu’il faut viser plutôt que les nationalistes noirs ou les communistes. Je confesse n’avoir absolument rien retenu de ces débats rébarbatifs, qui cherchent simplement à démontrer l’influence juive sur la politique américaine, et la volonté des juifs de réduire la race blanche à l’anéantissement par le métissage.
Inexplicablement, Yeager, qui a passé le tiers du roman à tuer sans aucun remords des gens en les regardant droit dans les yeux pour la plupart, estime que la violence ne résoudra pas les problèmes des américains blancs, et qu’il faut travailler à les réveiller sur le plan idéologique. De son côté, son commanditaire du FBI pense, lui, qu’il faut utiliser les juifs contre eux-mêmes, en exacerbant les tensions entre les groupes ethniques et idéologiques jusqu’à ce que puisse être mis en place un système d’essence totalitaire qui puisse ramener l’ordre sur tout ce beau monde. En toile de fond, le gouvernement continue de passer des lois perçues comme « anti-américains » (ou « anti-blancs »), alors que le chômage augmente et que le pays s’enfonce dans la violence armée inter-ethnique.
Yeager, devenu militant non-violent, s’engage donc dans la propagande, et rejoint une ligue politique. En rencontrant un homme à l’allure de prophète biblique qui s’avère être un excellent acteur, il va alors s’ingénier à convaincre les foules en usant de cet homme comme télévangéliste pour passer des sermons pro-blancs et anti-métissage…
La fin n’en est pas vraiment une: Yeager finit par éliminer son commanditaire, tandis que les USA s’enfoncent de plus en plus dans la crise, et ce alors même qu’ils commencent à éveiller les consciences…
C’est, honnêtement, nul du début à la fin. Passé le premier tiers, c’est même rébarbatif au possible, avec des discussions interminables sur le rôle des juifs, le rôle de la religion, et ce genre de choses. C’est un roman idéologique pur et dur, un pamphlet mal déguisé sous des atours romanesques, presque intégralement tourné contre les juifs, mais sans jamais s’étendre vraiment sur des arguments construits. Je ne vois même pas ce dont je pourrais discuter ici, que ce soit pro ou anti quoi que ce soit.
Conçu par Pierce comme un roman pour « ouvrir les yeux du lecteur contre les juifs », les arguments qu’il développe sont si nuls que le roman dessert son objectif et passe pour un mauvais tract de propagande. Là où les Carnets ne s’étendaient pas sur l’idéologie et laissaient place à des descriptions de choses entre les événements et les actions, Chasseur n’a même pas de logique interne et se perd totalement jusqu’à ne même pas offrir de conclusion. C’est, vraiment, un très mauvais roman, où on perçoit dès le départ que l’auteur ne savait pas trop au juste où il allait. Je pense que Chasseur a commencé comme une sorte de fanfic masturbatoire où Pierce s’est projeté tuer des noirs, des femmes blanches, et des juifs, avant de tenter de justifier ses écrits par une tartine pseudo-idéologique imbuvable. Non seulement Pierce est raciste et antisémite (et le fait bien savoir), mais il est en plus anti-chrétien, comme les néo-nazis bas du front peuvent l’être. Toute la seconde moitié du roman, où il recourt à Saul comme télévangéliste de foire pour convaincre les blancs chrétiens des bienfaits de la préservation de la race blanche est une insulte absolue envers les blancs croyants, qui constituent l’essentiel du public-cible de Pierce. Tout le paradoxe de Pierce est que ce qu’il écrit contre la religion chrétienne, c’est à dire essentiellement que le christianisme est une religion juive et donc « anti-blancs », est précisément issu de la littérature talmudique du 19e siècle qui a mené à l’émergence du courant protestant du « judéo-christianisme », un courant d’essence sioniste qui justifie le soutien des USA à Israel!
Pour justifier son sentiment anti-chrétien, jamais Pierce n’évoque le courant paganiste à la racine de l’idéologie néo-nazie qui est la sienne, issue des écrits du courant Völkish allemand et représentés de la manière la plus aboutie par le Mythe du XXe Siècle d’Alfed Rosenberg, qui inspirera toute l’imagerie pseudo-païenne de la SS d’Heinrich Himmler. En fait, c’est même à se demander si Pierce a la moindre once de culture et de connaissance sur les choses qu’il prône, tout laisse penser que ses écrits sont avant tout des opinions basées sur des préjugés plutôt que des convictions nées de l’expérience et de la connaissance.
Pierce n’aime pas les noirs, donc il est raciste, il est antisémite, donc il est néo-nazi, plutôt que l’inverse: il n’est pas animé par l’idéologie, mais habille sa haine sous des oripeaux idéologiques. C’est, purement, un véritable néo-nazi: une pâle et pathétique imitation de l’original, qui cherche à intellectualiser sa haine et à la justifier. C’est d’ailleurs évident dans le fait qu’il parle de livres et d’auteurs ayant écrit sur le sujet, sans jamais donner un seul titre ni nom. Il pouvait pourtant en citer beaucoup, ne serait-ce que l’un de ses maîtres à penser, Francis Parker Yockey et son célèbre ouvrage « Imperium », ou « le juif international » d’Henri Ford… S’il ne l’a pas fait, c’est, je pense, parce qu’il refusait de partager la vedette avec d’autres auteurs. C’est souvent le cas chez ce genre d’homme: ils doivent être les seuls sur l’affiche, refusant de la partager avec d’autres, même décédés, parce qu’ils se fantasment en nouveau Fürher, quand ils ne sont que de pathétiques petits hommes rabougris bouffés de haines et bouffis d’orgueil.